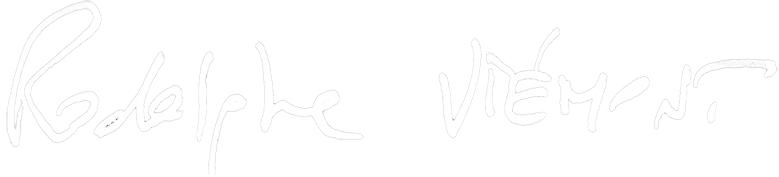Pro Domo « Pour Ernestine »
Les premiers retours sur Pour Ernestine sont plutôt bons. Mais celui d’une connaissance, producteur émérite, me paraît digne de m’y attarder. Cette personne, au demeurant respectable, me dit avec un ton qui simulait la gêne, presque comme le conseil de « celui qui sait » : « Le souci de ton film, c’est qu’il est intime et lyrique. » Intime et lyrique seraient donc deux défauts artistiques majeurs…
C’était la seconde fois que j’entendais ce genre de qualificatifs : Télérama avait dit d’Humeur Liquide qu’il était « clinique et lyrique ». J’avais pris ça pour un compliment – et je crois que ça l’était sous la plume de Pierre Murat. Mais voir reconvoquée cette terminologie une seconde fois, en critique négative, m’interroge : sur mon cinéma et sur mon époque. Où se tient l’art dans ce nouveau siècle qui devait être spirituel ou ne pas être ?
J’ai été très marqué par l’assertion de Deleuze (que j’ai découverte tôt, dès je posai de premiers mots sur une première feuille) : elle affirmait en substance que l’art ne peut pas être « une petite affaire privée ». Je me souviens également avoir été marqué ensuite par un dialogue entre Antoine Doinel et une de ses amoureuses d’où il ressortait qu’une œuvre d’art ne peut pas être une histoire de vengeance. Si ces idées m’ont puissamment traversé, c’est que je savais déjà que mon travail et mon intimité tricotaient chez moi intensément, plus fortement peut-être qu’ailleurs, jusqu’à ne plus savoir qui engendrait quoi ou quoi accouchait de qui.
Alors ? Pour Ernestine serait-il un objet personnel, fermé au monde, aveugle à autrui, dans lequel le spectateur ne peut pas se reconnaître, sur lequel il ne peut accrocher ni son regard, ni son identification ? Ce film serait-il masturbatoire ? Ou bien dit-il quand même quelques choses des appréhensions du créateur face à son œuvre, de la difficulté de devenir parents quand on a encore des rêves adolescents plein la tête, du sacrifice que tout artiste, maudit ou non, connu ou non, épanoui ou frustré, consent à son travail ?
Je pense plutôt que si cet « ami » producteur a perçu ainsi mon film, c’est qu’il (le film) développe et se développe dans des formes et des intentions, entendons-nous nullement neuves, révolutionnaires, encore moins géniales, mais qu’on ne voit plus guère aujourd’hui, et sur lesquelles il me plaît de revenir.
La société contemporaine voue un culte (assez fasciste à mon sens) à la performance et au bonheur (comme si celui-ci était de nature à être dressé en étendard). Société hygiéniste, on devrait en dix leçons de magazines ou vingt ateliers de coaching pour bobos CSP+ trouver the bonne méthode pour un orgasme « parfait », garder à la ménopause la peau lisse de la pucelle des plages qu’on a peut-être un jour été, et pour les plus cons posséder coûte que coûte sa Rolex à cinquante ans – ou t’as raté ta vie !
Alors, évidemment quand je revendique mon droit d’être borderline et freaks, plaintif et patraque, et pas drôle de surcroît ! ça jure dans le cadre. Les gens ont peur de la mort et de la folie car ils ont peur d’eux-mêmes. Tellement plus facile de couper court d’un méprisant « ton film n’intéresse que toi ! » que de se regarder, comme un miroir, parfois déformant, sur une toile blanche, tendue, en laissant l’identification bousculer. Mais il s’agit d’une méthode éprouvée, que l’anticipation pasolinienne n’avait même pas imagé à ce point : être distractif, la jouer entertainment à tous les niveaux, pour que les « sans dents », en bas de la pyramide, ne pense jamais à s’élever. Occuper le peuple. Lui fournir un bonheur prémâché, organisé, structuré, pour un ruissellement antalgique et anesthésiant.
On prend les gens pour des cons, « des veaux » disait une idole de la nation. Les universités n’élèvent plus intellectuellement, ne libèrent plus ; elles forment de parfaits professionnels, parfaits pour développer de parfaites entreprises. Et qu’on t’oblige à coloriser toutes tes images d’archive ! Et qu’on exige une voix-off bien claire, avec un ton journalistique de préférence !
Oui, le moyen le plus efficace de refuser de voir questionner ce qui, à moi, me paraît essentiel, la mort, la folie, l’inutile ou l’invisible, est de tout, toujours, ramener au matériel, à la matière, à la structuration, et de qualifier tout effort de penser la mort, la folie, l’inutile ou l’invisible, d’égocentrisme.
Le système est tellement bien pensé qu’il a même annexé la révolte. Celle-ci n’est qu’une sous-branche, close, qui participe à la grande messe. Dix millions de rebelles, anticapitalistes, athées, qui ont leurs médias, leurs quartiers, leurs Naturalia, leurs performeurs, leurs institutions publiques, qui se reconnaissent entre eux et excluent les freaks ou tout bancal, non pas de leurs jeux (ils en auraient le droit), mais de ce qui fait autorité, doit être ou ne pas être. Imposer ce qui est juste, bon. Ce qui constitue l’art. Le Salon des Refusés a aujourd’hui pignon sur rue et déborde de fric. Ils privatisent le noir absolu, encapotent la Concorde, pensent choquer le bourgeois en installant des vagins géants, mais oublient que la bourgeoise a changé de camps, que Robespierre s’appelait bien Maximilien De Robespierre, et que 68 est juste un juste un changement de générations, pas de paradigme social.
Ils savent : l’art c’est ça, ça va de là à là ; ici non ; là-bas surtout pas. Parfois, en fatigue et désolation, je me dis que c’est peut-être moi qui prend la marge, par misanthropie ou frayeur. Moi qui ne suis suffisamment cultivé pour comprendre les codes. Bref, qu’un cri n’est pas une œuvre d’art… Et il ne l’est pas. Mais qu’est-ce qu’un œuvre d’art au juste ? Je n’en ai aucune idée. Juste, je ne crois pas que ne pas me reconnaître dans leur révolte veuille dire que je suis un mauvais artiste…
Le cinéma contemporain a pour esthétique un naturalisme 2.0. Nous vivons encore artistiquement sans avoir dépassé 68. Le documentaire du 21ième siècle ressemble souvent à une thèse de sociologie ; c’est d’ailleurs souvent tout l’art contemporain qui ressemble à un discours de sociologie… La Cinéma Vérité a quand-même fait ce tour de passe-passe d’inventer une esthétique où la position suprême de l’Auteur est d’être le plus transparent possible ! Mais puisqu’on érige bien en génie Malevitch et ses monochromies, tout semble possible. Nous vivons dans un monde où l’intellect dirige la création, la pensée domine l’émotion.
Je n’ai l’intention (et encore moins la prétention) de convertir personne à mon discours. Je suis un spectateur heureux devant certains chefs d’œuvre de Cinéma du Réel. Je déplore en revanche une hégémonie des styles et des langages que je trouve stérilisante… et affamante. Un lecteur de commission a dit, en développement de Pour Ernestine, que le projet n’était pas assez « sociétal » pour être soutenu. Qui peut m’expliquer, sans cynisme, en quoi, sur le sujet de ce film, l’aspect sociétal est signifiant ? Introduire du sociétal dans mon film serait juste faire un tout autre film ; cela serait même un tout autre sujet. Que dois-je en comprendre ? Qu’il y a des films « légitimes » et que d’autres ne sont pas « conformes à ce que doit être un film » ?
Ainsi, une uniformité se dessine. Les bonnes langues parleront d’école ; je parle de vulgarité (au sens où cela manque de singularité). Combien de premiers films se ressemblent ?! Les réalisateurs sont souvent interchangeables. Même position sociale, même regard politique, même utilisation de la caméra. Que risquent ces artistes ? je veux dire : qu’abandonnent-ils pour leurs films ? Quel est leur sacrifice à leur œuvre ?
Ainsi, je prie chaque matin pour un art plein. Je prie pour un art qui déglingue, qui retourne : et le spectateur et le créateur. Un art fait de sueur, de sperme et de sang. Un art qui se contredit en permanence. Un art injuste mais fier. Un art qui produit de la beauté gratuite. Un art fait d’expérience, d’intimité. Assez des films sur les prisons ou les chômeurs, faits par des artistes habitant 150m2 à Odéon ! Assez des artistes qui clament leur appartenance à la gauche et te demandent, quand tu les ramènes chez eux, dans le 7ième, interloqués que tu puisses habiter à Goncourt : « Et ça va, y’a pas trop d’arabes dans ton quartier ? » On dit mon cinéma égocentré !? C’est peut-être juste que je ne cherche, moi, à voler la parole à personne.
Je réclame l’art de Maïakovski se heurtant au mur idéologique de Lénine ; l’art de Zweig, épuisé de l’horreur inimaginable du nazisme ; l’art d’Artaud que le cynisme intéressé de Breton tuera ; l’art de Basquiat manipulé par la Warholl Academy.
L’époque a besoin de héros, de romanesque, de trajectoires. De points de fuite. « La beauté sauvera le monde. » En tout cas, le nihilisme n’a jamais rien sauvé. En quoi le lyrisme serait-il un défaut ? En quoi penser l’homme dans ses sociétés serait-il plus artistique, cohérent, bienvenu ou plus estimable que de penser l’homme dans le cosmos ? Pourquoi mettre des frontières à la pensée, pourquoi créer des zones de non droit artistique ?
Le public est là, il vient voir mes films. Si tout le monde n’aime pas (et c’est tant mieux), il répond globalement positivement. Je ne demande pas la gloire, je n’attends aucun trophée. Juste : j’aimerais juste pouvoir développer un cinéma libre, avec ce en quoi je crois, sans qu’il soit méprisé, sans qu’on estime qu’il n’a pas à exister, malgré le public, parce le cinéma de « ceux qui savent » c’est ça et rien d’autres.