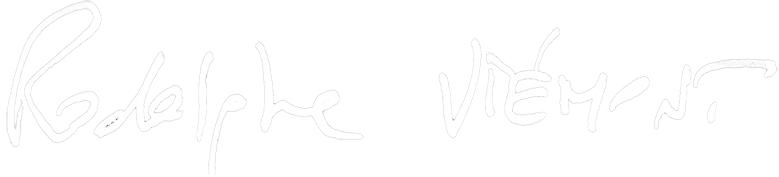Jacques Baratier n’avait pas tourné depuis 1989 (« L’Ami abusif »). Le retour à la réalisation (« Rien voilà l’ordre », sorti le 23 juin) de ce cinéaste du désordre, de la poésie rouge, surréaliste, est pratiquement passé inaperçu malgré un film entier, sensuel et profondément touchant.
« Je viens de sauver une femme »
La clinique psychiatrique du Rhien. Nom amusant mais lourd de significations, coincé, emprisonné entre le fleuve et le néant. Description du bâtiment d’un pano large. « L’aile droite du Rhien », « l’aile gauche du Rhien », et au centre de ce rien, une quinzaine de malades, en une Nef rococo, dans un joyeux parfois, douloureux souvent, brouhaha psychotique.
Doucement, on se ressert encore un peu, comme un raccord mental dans l’axe : Alexi [James Thierrée, émouvant], ex-futur musicien brillant, enfermé dans ses peurs, cloisonné, isolé du monde qui l’effraye, de sa mère castratrice, de la vie dans ce qu’elle a d’angoissant par son hasard… et son désordre.
Autour d’Alexi, « Aroulette » [magnifique Laurent Terzieff], placé ici pour échapper à la justice, faux tétraplégique, faux malade – les autres, l’appelant tous docteur, ne s’y trompent pas -, mais certainement le plus sensible et le plus vrai de tous ; Sophie [Aurélia Thiérée], amoureuse perdue d’Alexi, boulimique-mystique, petit être fragile, attachant, mais dangereux ; « le libertin » [Jean-Claude Dreyfus] très porté sur la chose ; le tout surveillé, ou plutôt contemplé d’un regard amusé par le docteur, le vrai cette fois, qu’un Claude Rich rend aérien, presque irréaliste.
L’ensemble semble tourner rond, dans une logique profondément illogique, jusqu’au jour où une intruse, une « impératrice » – de son métier (actrice), de l’aura qu’elle dégage -, vient faire un séjour à la clinique. Zelda [Amira Casar] est à reconstruire, perdue dans des culpabilités vraisemblablement infondées, dans une fuite mystique vers quelque chose qu’elle-même ne peut vraiment définir.
Son arrivée va bouleverser l’institution. Bouleverser Alexi surtout. Il a, pour la première fois, un acte de courage à faire, un acte de foi à accomplir ; elle, à redécouvrir l’attachement, la beauté des choses, la grâce de l’Autre. Leur histoire d’amour n’est pas explicitée ; elle est tout simplement : il ne pouvait en être autrement.
Zedla pense qu’elle pourra sortir Alexi de là, l’emmener avec elle, se reconstruire dehors, à deux. Alexi lui est lucide, il sait que Zelda, contrairement à lui, n’a rien à faire ici, en ce lieu clos, trop stérile pour elle. Car là n’était pas l’enjeu de leur histoire. Ils n’étaient pas fait pour finir ensemble, mais pour recommencer : Zelda retrouvera une pulsion de vie, Alexi retrouvera lui sa place d’homme – celle-là même qu’on lui niait en lui refusant un verre de bière sous prétexte qu’il avait déjà trop bu.
Un plan magnifique raconte à lui tout cela : après qu’ils viennent de faire pour la seconde fois l’amour – séquence magnifique dans une crypte d’une surréalité totale -, Zelda s’enfuit croyant Alexi endormi. Elle s’enfonce dans la profondeur de champ net du cadre, laissant son amant, les yeux ouverts tournés vers nous. Il sait déjà qu’ils se sont donnés ce qu’ils avaient à prendre l’un chez l’autre, et que leur proche séparation n’est pas triste puisqu’ils viennent mutuellement de se sauver de la folie définitive.

Douleur gracieuse
La douleur qui suinte de ce film n’est pas malsaine. Jacques Baratier ne fait un film sur, mais bien de malades mentaux. Il n’y a donc nulle pitié, nuls bons sentiments bien pensants. La souffrance qui s’en dégage, qu’il dégage en cinéaste expérimentée, est au contraire, oserais-je, gracieuse et aérienne.
Pourtant nombreux sont les moments noirs, les sous-séquences où les pleurs, les cris, les monologues déjantés, soliloqués, les colères auto-flagellantes nous rappellent les souffrances personnelles (« je me noie en pleine sécheresse » nous dit Zelda, sécheresse morale, et toute physique, sexuelle à ce moment du film).
Des voix-off impersonnelles se font entendre les unes sur les autres puis disparaissent, sans qu’on sache vraiment à qui elles ont appartenu. Des voix-off de lubies, de peurs et d’obsession. Comme si les pensées intimes des malades nous étaient données à entendre. Souvent même en hors champ. En hors champ sonore psychiatrique.
Mais Baratier, avec sa propension toute personnelle à féeriser les choses, transforme ces déchirures en de grands moments de force. Les références données par les malades eux-mêmes sont claires : Artaud, Mishima, Fellini.
Baratier joue sur la lumière, utilise le grain de la peau, le violon et la clarinette de la BO pour magnifier le suintement sanguin de ces écorchés vifs. Transpiration du beau, du sublime, lorsque la folie touche l’infini.
Une beauté toute mélancolique. Triste féerie. Ce feu flamboyant qui s’échappe de la fête annuelle de la clinique, décongelant les âmes, élevant dans le ciel des brindilles rougeoyantes, poussières de leur tristesse. Alexi qui danse dans la lumière d’un soleil couchant. Folie totale mais magie lumineuse, brillante.
Cette beauté douloureuse prend également corps en deux champs lexicaux entrelacés et splendides.
Tout d’abord par la mise en image de l’amour de Zelda et d’Alexi. Très charnelle, en plan très rapprochés, où les membres s’enlacent et s’emmêlent, en une fusion, malsaine pour un individu lambda, salvatrice pour eux.
Ensuite par une réelle mystification de certaines séquences. Bien que pour Baratier la religion soit plus aliénante qu’ouverte sur la vie (à Zelda alors qu’elle va quitter la clinique, on demande : « Tu n’as plus la foi ? Alors tu es guérie. »), le mystique a une très grande part chez elle (même dans la douleur). Elle refuse le monde pour se réfugier dans celui de la prière, lâchant prise par consomption religieuse. Par ce parallèle, cette sacralisation, quand bien même négative chez Baratier, la douleur de Zelda prend une dimension autrement esthétique et puissante.
L’érotisme évoqué plus haut est lui-même tout emprunt de sacré. Enfin, le malade, dans son universalité, est très mystifié, notamment par ce personnage récurrent, symbolique, tel un chœur antique contemplant, voire éprouvant, la (s)cène, sur fond d’image bleutée, les bras en croix.
Cette beauté qui perle de chaque dialogue tient peut-être également au fait que le scénario a été écrit en grand partie par Jacques Besse, poète, lui-même interné pendant 40 ans. La démarche est donc très différente des autres films traitant de l’univers psychiatrique. Ce n’est pas un copier-coller de racontars scénariques. Ici tout est brut, brut de folie. Tout y est tripes, avec un vrai regard sur la folie, très comique, sur ces délires individuels (souvent d’origine autobiographique) très tendres.
Jacques Baratier a gardé cette énergie insufflée par Besse, en intégrant (pas assez de son avis d’ailleurs) de vrais malades aux comédiens. Le mélange est parfaitement réussi, puisque total et sans frontière visible.

Frontière du rien
La clinique du Rhien « est une prison sans barreaux ». Car – même si la mise en scène insiste sur une frontière physique en surjouant par le son la barrière d’entrée de l’établissement – c’est bien d’une frontière intime dont il s’agit. Une frontière mentale. Libre est chacun de sortir de l’établissement. Mais le peuvent-ils vraiment – mentalement ? Le veulent-ils vraiment ? « — Qu’attends-tu pour partir ? — Je partirai quand je saurai où aller. »
Elle est là cette frontière qui transparaît dans chacun des protagonistes, frontière invisible mais tellement papable entre un ailleurs des possibles idéalisé et un temps présent, immobile (cf. le discours d’Aroulette sur la neige télévisuelle).
D’un côté, le monde, ouvert, grand : Paris et son espace, les voitures et leur mouvement, la télé et son voyeurisme, les familles des malades et leur tournoiements sexuels – cf. mère d’Alexi. De l’autre, l’asile, la folie, fermée, circulaire, repliée, souvent pourrissante, mais pas assez pour disparaître.
L’imagination est leur seule évasion, mais une imagination lucide et cynique : un patient voit dans le mot « médicament » un « amant merdique » (médicament devient merdicament puis amant merdique).
Puis au-delà même de cette frontière mentale : la frontière psychiatrique. A l’intérieur d’eux-mêmes. « Je suis coupée, séparée ». Un dédoublement des âmes : « Tu sais qui je suis, toi ? ». Fracture en eux-mêmes. Tout à reconstruire, comme ce malade qui refait des bonhommes (genre sculpture contemporaine) avec les déchets industriels qu’il glane lors de ses promenades.
Fracture avec le corps, façon Artaud. On prescrit à Alexi, niant son corps, un pack [1] ; Sophie rejette son enveloppe en se faisant vomir.
Et pourtant, cette fracture en eux-même, cette frontière qu’ils se sont instaurée, est profondément niée. Parlant de Zelda : « elle un grain… de lucidité » ou encore, lorsqu’elle craque, « le vrai est sorti ». La frontière, vue tout à l’heure, semble volontairement abolie ou tout au moins poreuse : il y a communication, infiltration du sain dans la folie (ou l’inverse). Une négation de la maladie : « Guérir ? Mais guérir de quoi ? ».
En fait, comme leur dit Aroulette, il n’y a qu’une chose à faire : c’est trouver la clef du spectacle qu’ils donnent. Car ils sont bien en représentation. La profession de Zelda n’est en cela d’aucun hasard, et nous renvoie immédiatement au champ lexical du masque.
Théâtralité de l’absurde – immersion surréaliste
Film étrange, à mi-chemin entre une liberté filmique élégante et assurée et un flou plus qu’approximatif. On hésite longtemps à émettre un avis tant on zigzague dans nos appréciations des séquences, jusqu’à ce que, happé par l’émotion du film, on lâche prise intellectuellement, pour ne nous focaliser plus que sur la matière même, livrée à nos seuls sens mis en éveil.
Ce flou est hautement maîtrisé. À mi-chemin entre ordre et désordre, justement. C’est l’essence même du travail de Baratier : l’ordre et le désordre des choses, des corps, des âmes. De « Désordre » (son premier court-métrage, 1950) à « Rien voilà l’ordre » aujourd’hui, la boucle est refermée. Tel « un peintre qui revient au motif » [2]. Cinquante ans à cerner, comme en un long travelling circulaire à l’épaule, les angoisses mentales mises bout à bout du malade, du fragile, de l’artiste, de la poésie et de l’extrême. Une expérience très surréaliste en somme, du rouge à l’or éclatant.
Baratier, tant dans ses choix de sujets que tant sa manière de filmer, est très surréaliste. Il laisse toucher une réalité autre. Un au-delà dont il s’approche avec grande élégance.
L’ensemble est très théâtralisé. Il n’y a pas vraiment de dialogue (tel qu’on les conçoit dans un film), tout est déclamé, puissamment, violemment, on se crie dessus plus qu’on ne se parle — pourtant la communication s’instaure. La bande sonore, jouant énormément sur les voix-off internes, les aberrations de plans sonores, les hors-champ, les superpositions de bruits, de cris, de paroles, renforce cet absurde très touchant, cette théâtralisation grand-guignolesque, mais à aucun moment lassante.
Certaines séquences vont jusqu’à l’absurde, on y croit pas, la narration est bancale. La clinique elle-même semble irréelle. Les soins ne sont quasiment pas montrés ; les entretiens avec le psy restreint à un seul exemple, très envolé, peu sérieux ; les patients parcourent les couloirs un bouteille de whisky à la main ; le docteur lui-même semble perturbé, la femme de ménage passe sa journée à chanter d’une manière fort étrange. Aroulette hésite entre une condition de malade ou de docteur, et le stagiaire médical semble effaré puis englouti dans cette nausée joyeuse mais délirante. Personne pour rattraper l’autre.
Pourtant nous nous satisfaisons très bien de cet absurde puisque nous sommes en permanence dans le ressenti. On touche à une féerie absurde, à la Artaud ou à la Beckett – on ne peut que rapprocher cela du théâtre de la cruauté et du théâtre de l’absurde. On est loin d’un documentaire médicale banal, stérile et bancal. Et peut-être là, justement, touche-t-on au vrai, à la réalité de l’état psychiatrique. [2]
Cette liberté tient lieu en grande part de la place laissée à l’improvisation sur le plateau. Très libres dans leurs gestes, les acteurs (notamment Casar) sont plongés dans une surréalité qui, loin de les dépasser, les nourrit profondément.
On sent dans ce film que tous, du scénariste au figurant, ont lâché prise pour se donner entièrement : ce film est, de tous les instants, à fleur de peau.
On regrettera donc cette sortie en salle réduite, éclipsée, presque muette. Ce film aurait mérité meilleur accueil. Mais cette immersion dans le milieu psychiatrique, de cette manière-là, n’est peut-être pas au goût de tous ? En notre époque qui cherche par tous les moyens possibles à banaliser la folie, à étouffer les douleur en les naturalisant sociologiquement.
[1] Technique psychiatrique consistant à envelopper le corps du patient dans un linge humide afin de faire éprouver au malade un sentiment d’unité corporelle.
[2] interview de Jacques Baratier in « L’Humanité » du 23 juin 2004.
[3] « Un film tout droit sorti des oubliettes, entre soap SFP et mauvais reality show avec de vrais-faux figurants, mise en scène ultra maladroite et montage au hachoir ». (sic !) in Première