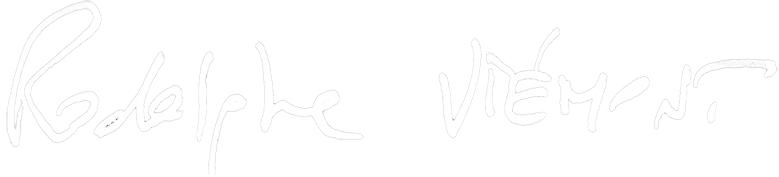Philippe Adrien, diplômé es grand guignol [1], nous offre à la Cartoucherie de Vincennes un « Yvonne, princesse de Bourgogne » [2] très fidèle à son auteur Gombrowicz. Etat d’un monde en déliquescence morale. Cruauté grinçante sous couvert de comédie cocasse et hilarante. Burlesque et poésie.
Un roi, Ignace, en un costume ridicule, couronne de carton pâte genre galette-des-rois sur la tête, se fend d’une diction toute risible. Sa femme, Marguerite, petit bout de femme riquiqui que la disposition du théâtre de la Tempête en gradins nanise encore en peu, offre une hystérie, qu’elle partage d’ailleurs magnifiquement avec son mari de roi. Un chambellan au phrasé lent, d’étiquette pompeuse, en une transition d’acte, se transforme en un cyclone amphétaminé, très rock’n’roll, complètement grotesque et guignolesque.
Vous êtes bien chez Witold Gombrowicz. Bienvenue en un théâtre « envoûté » [3], en un monde mis à plat, un monde horrible, faux et inhumain.
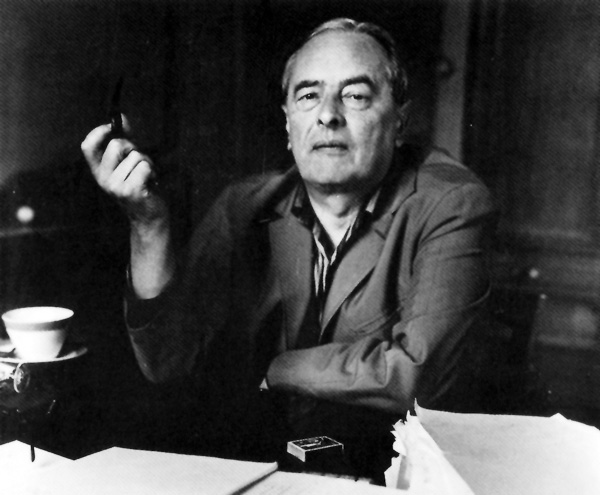
Ce « n’est pas un théâtre de l’Absurde, mais un théâtre d’idée »
« Yvonne » date de 1935. Gombrowicz ne connaissait à l’époque ni Beckett, ni Ionesco. Si ces univers se rapprochent, ils sont plutôt symptomatiques d’un état général de l’Europe, et avancent, parallèles, vers une déstructuration des formes. Mais d’école il n’y a point ; du moins avec Witold, libre penseur, détaché de toutes cliques, de toute intelligentsia ou doctrine.
Il voyait et pensait son théâtre comme un « humble théâtre d’amateur né loin dans le temps et dans l’espace ». Les trois pièces qu’il écrit dans toute sa carrière, presque en dilettante, l’ont été par un homme qui ne lisait jamais une ligne de théâtre. Et pourtant qui révolutionna celui. Il est des génies de cette trempe, qui, en un trait, une phrase, un dialogue, marquent à jamais leur art.
« Yvonne » est une parodie shakespearienne. Tout Gombrowicz est d’ailleurs parodie, théâtre comme roman. Avec une approche toute autre, il fut avec Wiktacy, le révolutionnaire polonais. Longtemps interdit, très tardivement monté à l’étranger (1998 ! pour la première adaptation d’« Yvonne » en France). Parodie de la structure, des personnages, de la mise en scène.
Philippe Adrien a respecté à la lettre les indications de Gombrowicz : « Il s’agit d’accentuer tous les éléments grotesques et comiques qui neutralisent la trame désagréable de la pièce, sans pour autant perdre de vue la lucidité et le naturel dans la psychologie des personnages et l’action. »
Gombrowicz parle également de « nonchalance », « liberté de texte », de costumes « contemporains […] dotés de quelques éléments fantaisistes (par ex. pour le roi […] une couronne…) », d’« effets de lumière », de « caractère onirique et irréel ».
C’est exactement la vision que Philippe Adrien nous offre du texte. De l’absurde, de l’humour, du grand guignol, des jeux de lumière totalement oniriques, un fond de décor (arbres) en vidéo surréaliste. Un grand rêve. Un grand et douloureux songe.
Beckett, Ionesco, certes. Mais Lewis Carroll aussi. Un palais enchanté et glauque à la fois. Des lumières toutes vertes, puis violettes ou bleues… Un songe effrayant et grandiose. Un lapin blanc traverserait le décor, des tasses danseraient sur la scène, qu’on ne serait nullement surpris.
L’interprétation, décalée avec des situations plutôt graves si on y regarde de près, est exceptionnelle. Aucun comédien ne peine. Force, puissance, justesse dans le ton. On sent la chose chirurgical, taillée au scalpel. Les trois rôles principaux sont éblouissants : Benjamin Guillard [le Roi Ignace] est tout à la fois drolatique et effrayant ; Camille Garcia [la Reine Marguerite] tendre et névrosée ; et Matthieu Marie [le Prince Philippe] est l’exemple même de ce que doit incarner un comédien sur scène : tension, tripes, sauvagerie tantôt, puis évanescence ensuite des mots. Tout passe en cet acteur, certainement rappelé à la ressource au dernier moment, si l’on se fit à son nom collé à la va-vite sur le programme. Et c’est tant mieux, tellement on doute qu’un Philippe puisse être mieux incarné.
Le Roi : « Tout est permis avec elle. »
« Yvonne » est l’état des lieux d’une humanité en désespérance, en déliquescence. Perversion inhérente à l’amour du prochain. « Yvonne » est une réflexion sur le regard humain. C’est un miroir atroce et véridique sur nous-mêmes, notre miroir. Notre horreur. Notre sadisme ; et notre vide.
Royaume de Bourgogne, un monde clos, parfaitement en ordre. Un roi bien gentillet, adulé. Une reine qui apaise son ennui dans l’écriture de poèmes ridicules. Une cour parfaitement mécanisée, heureuse de l’être. Un prince qui badine. Tout est structuré, mathématiquement ordonné.
Et puis Yvonne. Yvonne, l’antithèse même de la beauté, de la finesse, du désir. De la vie. Une Cendrillon de placard, de bas étage, gauche et silencieuse, que seuls des adjectifs dédiés aux plantes et aux mollusques vont qualifier dans la bouche de tous les protagonistes. Yvonne, la laide ; Yvonne, la décérébrée ; Yvonne… la silencieuse. [4]
Par défi au père, à l’étiquette, à la Forme, au protocole, Philippe décide d’embrasser la douleur de cette malheureuse, c’est-à-dire de l’épouser. L’adolescence tardive du prince bute sur le mystère Yvonne. De la pitié ? Non, certainement pas. De l’égoïsme ! Il ne s’agit nullement de la sauver, mais bien de se sauver, lui !
Cet acte, salué finalement par sa mère, après l’horreur de l’annonce, d’une « Plus la fiancée est vilaine, plus le geste est beau. », n’a qu’un seul but : gripper la machine. Qu’un seul objectif : se voir vivre, se sentir exister en tant qu’individu.
Le Prince : « C’est seulement maintenant, quand je la regarde, que je me sens vraiment prince, prince jusqu’à la moelle des os. Sans doute ne connaît-on sa propre supériorité que le jour où on a déniché quelqu’un de très inférieur. »
Et cette grandeur sadique, par comparaison idiote (car inutile), va grandir tout le monde – dans un premier temps du moins : le roi, la reine, Cyril, ami du Prince, la cour. On joue avec la misérable, on la trimballe d’un bout à l’autre la scène, une corde au cou, vache ou chèvre, la raille, l’humilie.
En faire une lecture politique ? Pas forcément. Mais pourtant tout à la fois : fascisme, Sade, Pasolini…
Mais c’était sous-estimer la force d’Yvonne, la force mentale de ce légume, sa volonté à résister, à être. De tous les personnages, de toutes ces névroses hystériques, une seule sort gagnante : celle d’Yvonne, LA rebelle, LE grain de sable que l’on introduit, et qui, sans surveillance, par défaut, fait dérailler le système bien plus que prévu.
Car Yvonne est le repoussoir parfait dans la mesure où elle révèle à chacun non ce qu’il croit être, mais ce qu’il est en vérité. Elle les oblige tous, les uns après les autres, plus ou moins rapidement selon l’importance de leur ego, en se confrontant à sa résistance à demeurer débile, aphasique, à rencontre leur propre image. Elle est un miroir, un miroir grossissant de leur failles, de leur faiblesse et leur petitesse.
Le roi s’animalise, laisse parler ses pulsions sexuelles, ses désirs assassins. La reine doute de ses poèmes et se révèle dangereusement folle. Les courtisanes se sentent, enfin, ridicules… La propre peur d’Yvonne déchaîne la violence et fait naître à son tour la peur chez les autres : peur de soi-même, peur de l’autre, peur de son passé, de son avenir, de l’amour.
Ils rencontrent leur propre vice, leur propre vide. Car ils sont morts ! Bien morts ! Face à ce Rien qui les constituent et qu’ils se prennent en pleine face, une unique solution : briser le miroir. Tuer Yvonne. Et « par le haut » s’il vous plaît. C’est-à-dire avec les formes, avec les honneurs, non pas dus à elle, mais dus à eux. Une arrête de perche étouffe le grain de sable. Le palais retrouve sa paix, même le prince en finit de sa crise existentielle : il s’agenouille avec les autres sur le corps de la « mollassonne ». Capitulation du désir d’exister.
À l’envie d’être soi, incarné puissamment par deux personnages résistants aux formes, Yvonne et Philippe, deux réponses bien distinctes, deux réponses de l’Humanité face à l’Individu (et la grandeur n’est pas dans l’apparence) : le renoncement (le Prince) ou la mort jusqu’au-boutiste (Yvonne).
Yvonne, la bête, est en cela bien le héros de la pièce. Romantique ! Intègre ! Tragique ! Et malgré sa mollesse, bien vivante ! Elle est la plus vivante de tous. Martyr volontaire et assumée. Sa beauté est d’un autre ordre. Sa lumière, son soleil. Le premier mot qu’elle extrait de sa gorge nouée mais volontaire est d’ailleurs pour confirmer aux nihilistes qui la raillent son amour de Dieu.
Saluons la prestation de Sarajeanne Drillaud, incarnant ce laideron sombre d’apparence. Il n’est pas donné à tout le monde de faire exister un tel personnage (riche, complexe, rude et tendre à la fois) juste par sa gestuelle et sa présence scénique.
« Anarchie illimité de la Forme »
Il existe un parallèle entre cette force, cette liberté d’Yvonne, son refus de se mouler au protocole, et la liberté formelle même de la pièce.
Gombrowicz faisait l’état des lieux d’une forme théâtrale « perfide, répugnante, incommode, rigide et désuète » [5]. Le grand combat de Gombrowicz (tout aussi présent dans son œuvre romanesque) : « Lutter avec la Forme ». Déstructurer, recomposer. « Yvonne » est bien une pièce de l’entre-deux guerres.
« J’entends par Forme toutes les façons de nous manifester, comme la parole, les idées, les gestes… et qui nous sont imposés par les autres. »
Pour cela, Gombrowicz s’appuie sur une structure traditionnelle. Son désir : « Trimbaler la plus actuelle contrebande dans de vieilles carrioles » [6].
Construction dramatique tout d’abord : 4 actes. Figures classiques et universelles de la tragédie : roi, reine, prince… Un comique simple : comique de mots (répétition, calembours), comique de situation (jeu de cache-cache derrière les meubles)… Structure comme on l’a vu shakespearienne, tragi-comédie et panache de la langue.
Mais Gombrowicz dégrade, coupe les liens, rend grotesque. Un champ lexical décalé, des anachronismes de la langue (maintes fois démultiplié par la traduction très contemporaine – et assez dans l’esprit de l’auteur – de Kinga Wyrzykomwska) : les « grouille-toi » contrastent avec la préciosité et l’onirisme des décors et des costumes.
Le cours ordinaire de la progression dramatique est également profondément perturbé. Tout semble déjà joué au premier acte (le roi et la reine ont accepté le mariage avec Yvonne). Les trois autres actes ne font en fait que « dévider un thème abstrait et parfois absurde un peu comme un thème musical » [7]. On passe de l’ordre à l’ordre, rien n’a changé en deux heures.
« Yvonne » est une sorte de défi au théâtre et à ses règles de base : elle ne bouge pas, ne parle pas. Yvonne dépasse le miroir qu’elle tend indéfiniment aux autres protagonistes. Yvonne, c’est nous, les spectateurs, immobiles et silencieux face à la cruauté de ce qui se déroule devant nous : Gombrowicz construit cette pièce avec et autour d’un « rien ».
Il y a une sorte de malice chez Gombrowicz à écraser la Forme, la malaxer, expérimenter son contenu et son enveloppe. « N’oubliez pas que chez moi la Forme est toujours la parodie de la Forme. Je m’en sers mais je m’en extrais. » [6] Parodie : tout est là.
Vraie recherche donc chez Gombrowicz, une vraie volonté de changer, transformer, alchimiser la Forme. Démarche très dadaïste ou absurde d’une part, très polonaise d’une autre. Reste que le travail de cet auteur phare, et « Yvonne » en est un excellent exemple, est duel, à la fois libre et enclavé, insouciant et conscient du monde qui l’entoure : la création artistique selon Gombrowicz est à la fois la « maturité » (car elle tente de donner forme au chaos intrinsèque du monde) et « l’immaturité » (car elle permet de déployer créativité et liberté).
[1] Il a monté en 2003 « Cadavres exquis ».
[2] En réalité « Yvonne, princesse DU Bourgogne », le vin, si l’on s’en tient au texte polonais.
[3] Cf. « Les Envoûtés », roman de 1939, peut-être la quintessence du caractère surréaliste et décadent de Gombrowicz.
[4] Des 25 répliques d’Yvonne que comptait la pièce en 1938 à sa première représentation publique, il n’en reste, après coupes de Gombrowicz lui-même, et coupes de traducteurs, que 2 dans la version montée par Adrien.
[5] in « Journal », t. 2
[6] in « Testament »
[7] in « Souvenirs de Pologne »