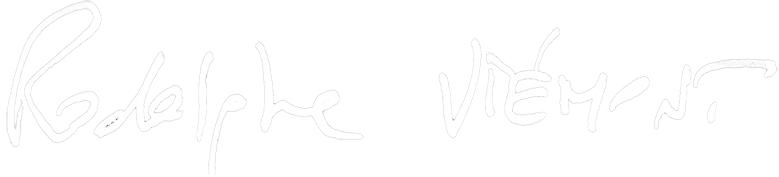Il ne se passa que peu de temps entre l’envoi du scénario par mon épouse et l’appel de Marie Audigier[1] : « Jean-Louis a beaucoup aimé votre texte : peut-on se voir tous les quatre prochainement ? »
Cela faisait dix ans que Murat était au cœur de nos vies, ancré dans notre intimité : nous avions ouvert notre bal de mariage sur sa chanson Aimer (Que le corp vivant ce monde / Vive heureux chaque seconde / Comme un amant ruisselant.[2]) et dix ans plus tard, notre fille chantonnerait ses chansons en onomatopées, avant même de maîtriser correctement le langage.
En lui j’aimais tout : ses mélancolies de french bluesman, sa poésie ancrée dans la terre et les éléments ; et plus encore peut-être sa voix sensuelle, sexuelle, entendue pour la première fois dans un train bleu (aux coussins roses bien sûr) entre Lyon et Genève[3]. Quant à sa mélancolie, elle me semblait issue de ce romantisme allemand que je chérissais tant, même si le concerné revendiquait plutôt des influences italiennes. Donnez-moi la lumière / Sur ce chant muet / Ce long chant de misère / Et de vanité.[4] J’aimais son intransigeante liberté (son mauvais caractère). J’aimais sa rigueur et sa douceur.
Ainsi envisager que Jean-Louis Murat pût être le rôle masculin de mon premier long-métrage était une folie que nous avions pensée à deux, Laurence et moi, un soir d’alcool, avant d’écrire ce scénario très rock, presque punk, dans lequel nous voyions parfaitement l’auteur des Jours du Jaguar. Nous pensions son univers bourru et poétique capable de soutenir ma misanthropie et mon mysticisme. À moins que ce fût l’inverse.
Marie nous proposa une rencontre après le concert aux Sables d’Olonne où Murat partageait l’affiche avec Thomas Fersen. Nous étions en juillet 2012. C’était la tournée Grand Lièvre.
Après plusieurs heures de route vers l’océan, nous posâmes nos affaires dans un petit hôtel de bord de mer et descendîmes, très tôt, pour dîner. Nous étions seuls. Le silence de la pièce m’oppressa. L’imminence de la rencontre avec (oserai-je le mot ?) mon idole me stressait. Une bouteille de blanc, un Tercian 25, et finalement un Alprazolam 50 n’enterrèrent pas mon angoisse. Je touchai à peine au dîner, nous longeâmes le bord de mer jusqu’à la salle de concert et nous installâmes au fond.
Fersen remporta un large succès. À sa suite, Jean-Louis proposa un concert très rock, (sans bassiste, avec sa seule guitare et la batterie de son fidèle Stéphane Reynaud) qui en découragea beaucoup : un quart de la salle se vida.
D’où les premiers mots de Murat à notre endroit quand Marie nous introduisit dans les loges après les dédicaces : « Ça allait quand même sans bassiste ? »
On s’assoit. Étrangement je déstresse. Au pied de la montagne auvergnate, elle me paraît moins acérée que dans mon imaginaire. S’instaure alors entre nous deux un jeu étrange de séduction, dans lequel je me trouve assez mauvais. Jean-Louis ne s’adresse qu’à moi. C’est une histoire entre artistes, semble-t-il signaler à Laurence et Marie.
Murat se montre totalement ambivalent : il dit avoir très envie de mon film mais fait tout pour me décourager : « Je ne suis pas un acteur ! » Je me dis qu’il attend peut-être que je lui rétorque ses deux rôles chez Doillon et Bailly – deux prestations dont il n’a pas à pâlir. Mais je ne le fais pas, sans savoir pourquoi, et préfère rappeler au contraire que Bresson, dont nous sommes deux admirateurs, n’a tourné qu’avec des non-professionnels. Il me semble que Jean-Louis n’aime pas mon argumentation. Et a posteriori, je le comprends.
Il enchaîne : « Je devais tourner avec Kieslowski aussi ! » Se retournant vers Marie : « On avait signé, je crois. Je ne suis jamais allé sur le plateau. » Que répondre ? Que moi, jeune cinéaste, s’il me faisait cela je ne m’en relèverais pas ? De toute évidence, Murat teste mon désir. J’esquive et dévie sur ce que nous partageons : la Loire qu’il voit naître et que j’aime voir, neuf cents kilomètres plus bas, avancer vers la mer ; les animaux ; la terre et son odeur ; les valeurs paysannes, se lever tôt, travailler[5] ; la détestation des interviews ; une certaine forme de misanthropie, d’allergie à la connerie et à la laideur ; une sensibilité qui écorche et nourrit.
On poursuit la discussion un étage plus bas, après avoir rejoint l’équipe du concert pour fêter la signature de l’artiste chez PIAS. « Vous savez ce que veut dire PIAS ? » lance Jean-Louis. Je le sais (« Play It Again, Sam ») mais reste coi. Autant tous les quatre, là-haut, ça allait, autant ici, avec dix ou douze personnes, je ne suis plus du tout à l’aise. Je me retrouve à boire du champagne pour célébrer un contrat qui m’est étranger. Je ne suis pas à ma place.
Le mot est lâché : la place. Moi qui n’ai jamais été marqué par le Nom-du-Père, ma place me fait défaut ce soir encore. Quid de cet Idéal du moi que je pose sur Murat (qu’il doit bien deviner dans mon propos) ? Quid de son propre désir de cinéma qu’il fuit ce soir (mais que je ressens fort en lui) ? Tout mon embarras à me poser en directeur. Toute sa difficulté à ne se faire que simple interprète. On s’épie, on se cherche. Il y a quelque chose d’insaisissable chez lui, et de tellement enfantin chez moi. Oh ! Pourquoi m’as-tu fait Dieu / Ce môme éternel ?[6]
Marie en revient au film. Qui pour jouer le rôle féminin ? J’avance : Sandrine Kiberlain. « Elle est toujours fourrée avec Lætitia[7]. Tu peux lui en parler, non ? » propose Marie à Jean-Louis. Oui, pourquoi pas. « On fait des essais à Noël ? » Ok ! C’est vendu !
La belle histoire s’arrêtera là. Les essais n’auront jamais lieu, malgré l’envie de Marie de faire aboutir le projet. Aucun producteur ne montera sur le film ; je n’étais pas prêt à tourner mon premier long ; et Jean-Louis était pour le métier, disons-le, « pas assez bankable. » Fucking business.
Quelques temps plus tard, nous nous reverrons à Évreux. Nous rediscuterons un peu du film puis Murat, s’en retournant signer albums et photos, me lancera en guise d’au revoir : « Je suis votre fidèle ! ». Le film abandonné, on se perdra de vue. Je lui enverrai un DVD de Pour Ernestine. Il ne me répondra pas. J’en serai très déçu.
Quelques semaines avant ce fatal 25 mai 2023, je lui proposai de composer la bande originale de mon nouveau film : j’avais entre temps fait mon trou en tant que documentariste, où il n’y a qu’un seul maître car pas d’interprète. Il était question que nous en parlions prochainement. Mais une bête phlébite en décida autrement.
Peut-être est-il bien là où il est. Je pense même que, comme il l’a chanté, les éperviers veillent sur son âme[8]. Mais je ne peux m’empêcher de ressentir ce départ précipité comme absurde. La mort est dégueulasse.[9]
Nous n’aurons jamais travaillé ensemble. Nous n’aurons pas trouvé nos places l’un par rapport à l’autre. Notre histoire aura été un rendez-vous manqué. Nous n’étions pas intimes. Il me manque cependant et ce manque est désormais impossible à combler (Chht chhht pas de bruit / Sur la mort de Jean-Louis / Presque rien / Sur ses vertus d’arlequin.[10]). Dans ce vide me reste une certitude : Murat restera une référence majuscule dans mon univers artistique et mon imaginaire, y occupant à jamais une place bien à part.
[1] Ex-femme de Jean-Louis Murat et alors son manager.
[2] Aimer (album Dolorès, 1996).
[3] Le Train bleu (album Dolorès, 1996).
[4] Fort Alamo (album Dolorès, 1996).
[5] Interview dans Le Point du 9 décembre 2011.
[6] Le Môme éternel (album Dolorès, 1996).
[7] Lætitia Masson.
[8] « Je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront » (Col de la Croix-Morand, album Le Manteau de pluie, 1991).
[9] Taormina (album Taormina, 2006).
[10] Margot (album Dolorès, 1996).